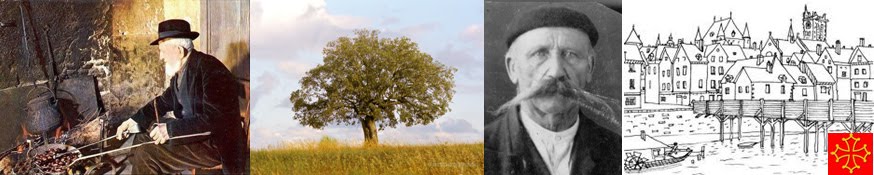A priori, cette profession qui rend des services indispensables à des multiples d’autres, ne semble pas être représentée à la hauteur qui aurait dû l’être parmi celles des PAUZAT et POUZAT recensés dans notre base généalogique[2]. Qu’en est-il vraiment ?
En quoi consiste le métier de charron.
Un charron est une personne spécialisée dans la construction et la réparation des véhicules à traction animale, notamment dans le cintrage et le cerclage des roues.
De façon plus précise, citons :
« Á partir du moment où l'homme a utilisé la roue pour construire des véhicules, il y a eu des charrons. Ce métier existe probablement depuis plus de 4000 ans.
Charron vient tout droit du métier de charpentier puisque déjà dans le haut Moyen Âge, il faut maîtriser le travail et l’assemblage du bois pour bâtir châteaux et cathédrales. Parmi les différentes spécialisations est né le métier de charron qui s’est consacré à la fabrication des charrettes et autres moyens de roulage même si à la campagne, le métier présentait une polyvalence plus large.
Tout d’abord le charron s’occupait de l’outillage du jardinage et des champs et des bois. Il façonnait de nouveaux manches pour les bêches, fourches, les râteaux, les haches et les pioches. En morte-saison, il fabriquait et réparait les râteaux pour retourner le foin. Mais le gros de son travail consistait à construire les charrettes, tombereaux, surtout les voitures des paysans du village.
La fabrication de la charrette demandait une dextérité et un savoir-faire importants notamment pour la confection des roues qui constituait la partie la plus délicate du travail ; c’est à leur solidité et à leur longévité que le charron devait sa renommée. Leur réalisation reposait sur de longs mois d’apprentissage et faisait appel à des notions de physique, de géométrie, de dessin, plus une connaissance affirmée du bois et de son travail ».
L’atelier de charronnerie était indispensable à chaque village, au même titre que celui du forgeron ou du maréchal ferrant. En 1840, on estimait qu’en Lorraine il y avait environ un charron pour 300 habitants. Mais à partir du milieu du 20e siècle, ce métier devint obsolète.
Combien de nos ancêtres furent-ils charrons ?
À ce jour, on en recense que quatre dont trois le furent de père en fils en Guyenne, au nord-ouest de Périgueux. Le quatrième vivait en Auvergne au nord de Clermont-Ferrand.
En quoi consiste le métier de charron.
Un charron est une personne spécialisée dans la construction et la réparation des véhicules à traction animale, notamment dans le cintrage et le cerclage des roues.
 |
Ateliers de
charrons et sculpture
d’un charron à l’église de Heudicourt dans l’Eure.
|
De façon plus précise, citons :
« Á partir du moment où l'homme a utilisé la roue pour construire des véhicules, il y a eu des charrons. Ce métier existe probablement depuis plus de 4000 ans.
Charron vient tout droit du métier de charpentier puisque déjà dans le haut Moyen Âge, il faut maîtriser le travail et l’assemblage du bois pour bâtir châteaux et cathédrales. Parmi les différentes spécialisations est né le métier de charron qui s’est consacré à la fabrication des charrettes et autres moyens de roulage même si à la campagne, le métier présentait une polyvalence plus large.
Tout d’abord le charron s’occupait de l’outillage du jardinage et des champs et des bois. Il façonnait de nouveaux manches pour les bêches, fourches, les râteaux, les haches et les pioches. En morte-saison, il fabriquait et réparait les râteaux pour retourner le foin. Mais le gros de son travail consistait à construire les charrettes, tombereaux, surtout les voitures des paysans du village.
La fabrication de la charrette demandait une dextérité et un savoir-faire importants notamment pour la confection des roues qui constituait la partie la plus délicate du travail ; c’est à leur solidité et à leur longévité que le charron devait sa renommée. Leur réalisation reposait sur de longs mois d’apprentissage et faisait appel à des notions de physique, de géométrie, de dessin, plus une connaissance affirmée du bois et de son travail ».
L’atelier de charronnerie était indispensable à chaque village, au même titre que celui du forgeron ou du maréchal ferrant. En 1840, on estimait qu’en Lorraine il y avait environ un charron pour 300 habitants. Mais à partir du milieu du 20e siècle, ce métier devint obsolète.
Combien de nos ancêtres furent-ils charrons ?
À ce jour, on en recense que quatre dont trois le furent de père en fils en Guyenne, au nord-ouest de Périgueux. Le quatrième vivait en Auvergne au nord de Clermont-Ferrand.
* vous pouvez visualiser la courte vidéo ci-dessous montrant un aperçu du métier de charron
- Jean PAUZAT (n°3537) né à Douchapt en 1827
- François PAUZAT (n°987), son fils, né à Douchapt en 1862
- Adolphe PAUZAT (n°4432), le petit-fils du premier, né à St-Méard-de-Drône en 1896
- Auguste POUZAT (n°3232) né à Varennes-sur-Morge (Auvergne) en 1902. Pour information, il sera charron au Cheix sur Morge en 1930, à Ennezat en 1931.
Remarque : S’il n’a pas été trouvé de charrons durant l’Ancien régime, ceci semble être dû au fait que le métier était rarement cité dans les actes paroissiaux, contrairement aux actes qui suivirent. On pourrait donc imaginer qu’il y aurait eu davantage de charrons portant notre patronyme.
Malgré ce handicap de notre recensement, le nombre d’individus trouvés semble apparemment faible. Mais si pour la même période (1800- 1950), l’on rapporte celui-ci au nombre d’individus recensés dans notre base, on trouve un ratio de 4/793, soit 1 charron pour environ 200 personnes, ce qui est du même ordre de grandeur que celui indiqué pour les villages lorrains. Nos ancêtres exercèrent donc ce métier au même titre que leurs concitoyens et sont bien représentatifs de la répartition de ce métier dans notre pays.
[1] Journalier, métayer, propriétaire, etc.
[2] A ce jour, on y dénombre 1935 individus de sexe masculin ayant porté notre patronyme et ayant vécu entre la fin du 17e siècle et celle du milieu du 20e.
- Jean PAUZAT (n°3537) né à Douchapt en 1827
- François PAUZAT (n°987), son fils, né à Douchapt en 1862
- Adolphe PAUZAT (n°4432), le petit-fils du premier, né à St-Méard-de-Drône en 1896
- Auguste POUZAT (n°3232) né à Varennes-sur-Morge (Auvergne) en 1902. Pour information, il sera charron au Cheix sur Morge en 1930, à Ennezat en 1931.
Remarque : S’il n’a pas été trouvé de charrons durant l’Ancien régime, ceci semble être dû au fait que le métier était rarement cité dans les actes paroissiaux, contrairement aux actes qui suivirent. On pourrait donc imaginer qu’il y aurait eu davantage de charrons portant notre patronyme.
Malgré ce handicap de notre recensement, le nombre d’individus trouvés semble apparemment faible. Mais si pour la même période (1800- 1950), l’on rapporte celui-ci au nombre d’individus recensés dans notre base, on trouve un ratio de 4/793, soit 1 charron pour environ 200 personnes, ce qui est du même ordre de grandeur que celui indiqué pour les villages lorrains. Nos ancêtres exercèrent donc ce métier au même titre que leurs concitoyens et sont bien représentatifs de la répartition de ce métier dans notre pays.
[1] Journalier, métayer, propriétaire, etc.
[2] A ce jour, on y dénombre 1935 individus de sexe masculin ayant porté notre patronyme et ayant vécu entre la fin du 17e siècle et celle du milieu du 20e.