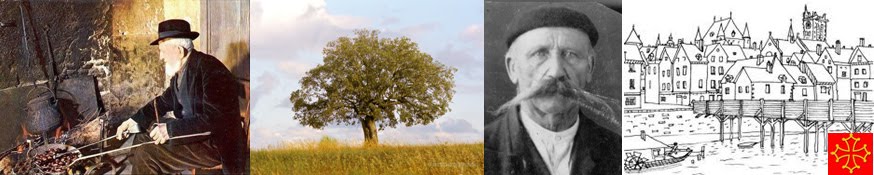Quelques-uns de nos ancêtres eurent affaire à la justice, étaient-ils coupables ou innocents ? Certains témoignages les concernant sont parvenus jusqu’à nous. Jetons donc un regard curieux sur ceux-ci.
Précisons au préalable deux critères importants : l’exercice de la justice et les supports de mémoire, car selon l’époque où les faits se sont déroulés ces derniers sont totalement différents.
En premier lieu, durant l’Ancien Régime, la justice était diverse
[1] et il existait « une multitude de modalités à respecter avant l'application de la peine capitale, selon le crime et la condition du condamné. Le droit pénal de l'Ancien Régime comportait des peines afflictives destinées à faire souffrir le coupable et des peines infamantes destinées à l'humilier. Les peines n'avaient pas pour but de punir ou d'amender le coupable, mais d'impressionner les spectateurs, de servir d'exemple, de dissuader le public de commettre des crimes
[2] ».
D’autre part, « l'emprisonnement ne figurait pas encore parmi les peines, il ne servait qu'à détenir la personne accusée en attente du jugement, ou alors comme peine de substitution en cas de grâce ».
En second lieu, durant cette même période, rares sont les témoignages de l’action de la justice sur le « bon peuple » où les acteurs sont désignés nominativement. Avant l’invention de l’imprimerie et longtemps après, l’information est véhiculée par voie orale et par affichage. Par la suite, l’analphabétisme limite la portée des gazettes, celles-ci étant de toute façon en très petit nombre. Il ne reste donc que les écrits consacrés aux grands faits historiques ayant fait l’objet de rédaction d’actes et de manuscrits.
Citons les écrits de l’Inquisition en terres cathares où par exemple, tous les habitants d’un village comme celui de Montaillou
[3] furent, à la fin du XIII siècle, identifiés et interrogés. Leurs noms et leurs histoires nous sont donc connus. Les cas isolés, par exemple celui de l’assassinat du roi Henri IV en 1610 laissa à la postérité le nom de son assassin François Ravaillac. Mais, pendant cette période aucun Pauzat ne vit son nom accéder à la mémoire collective.
De ce fait, les informations dont nous disposons sont toutes postérieures à la Révolution française et contemporaines de la presse écrite. Celle-ci s’étant développée qu’à partir du 19e siècle, les témoignages existants datent donc logiquement de la période qui suivit.
Notons aussi que si certains de nos ancêtres, cités plus bas, furent condamnés à la peine de mort, le hasard voulut que l’un fût exécuté étant innocent, alors qu’un autre fut gracié après avoir commis un crime odieux !
 la guillotine[4] le métier de corroyeur le métier de porteur d’eau[5]
la guillotine[4] le métier de corroyeur le métier de porteur d’eau[5]
Examinons maintenant les faits recensés :
Léonard PAUZAT[6] en 1794 à Bordeaux
Agé de 47 ans, natif de Dussac en Dordogne, il fut condamné à mort le 4 juillet 1794 (16 messidor de l’an 2) durant la Terreur
[7], par la commission révolutionnaire de Bordeaux comme receleur de prêtres réfractaires. Il a été guillotiné place Nationale (l’actuelle place Gambetta).
Il fut arrêté et condamné avec « le prêtre Cazeaux et onze religieuses ou pieuses femmes qui avaient caché ce dernier. Pour sa part, il n’était qu’un humble porteur d'eau du couvent du Bon Pasteur ».
Il n’eut pas de chance à double titre, premièrement parce qu’il était innocent et n’avait commis aucun méfait, mais aussi parce qu’il eut la tête tranchée juste quelques jours avant la fin de la Terreur, celle-ci s’achevant le 28 juillet 1794 avec la chute de Robespierre.
remarque : son prénom laisse supposer que sa famille est originaire du Limousin.
Lucien POUZAT en 1913 à Paris
Télégraphiste, âgé de 15 ans, il avait pris l’habitude avec certains de ses jeunes collègues d’ouvrir les pneumatiques (imprimé bleu dont les anciens se souviennent certainement) et ainsi de satisfaire leur curiosité pour découvrir quelques secrets, profiter de tuyaux aux courses, etc.
Mais un jour, Lucien apprit ainsi qu’une jeune femme de 29 ans, Mme Juliette S… habitant le quartier avait une liaison avec le patron de son mari. Il eut l’idée de la faire chanter en lui réclamant pour son silence 150 francs
[8] en 3 coupures de 50 francs.
Arrêté, il fut rendu à ses parents, car la dame ne porta pas plainte, mais le commissaire prévint l’administration des P.T.T. qui ouvrit une enquête sur la façon dont ses petits facteurs violaient les secrets des correspondances qui leur étaient confiées.
Joseph POUZAT en 1923 à Gannat
Citons : « le 2 septembre 1922, un bourrelier-corroyeur
[9] de Gannat, se rendit à Issoire pour y voir sa fillette Madeleine, une enfant de huit ans, confiée à des parents domiciliés dans cette ville. Ayant amené la gamine en promenade et se trouvant avec elle dans un endroit écarté, il la saisit brusquement par les cheveux et lui trancha la gorge d’un coup de couteau, avant de jeter le cadavre dans un fossé rempli d'orties.
Arrêté peu après, il avoua son crime, déclarant qu’il avait tué la pauvre enfant pour se venger de sa femme qui avait demandé le divorce contre lui. Joseph Pouzat à comparu hier devant la cour d’assises du Puy-de-Dôme qui l’a condamné à la peine de mort ».
Cependant, il fut gracié le 19 avril 1923.
Germaine PAUZAT en novembre 1929 à Saint-Mandé[10]
Citons : « une bonne âgée de 27 ans, Germaine Pauzat, avait disparu de chez son patron, M.Branger, rue de l’Alouette à Saint-Mandé, en emportant une somme de 500 francs
[11] ; arrêtée, elle a été envoyée au dépôt ».
Rappelons aussi d’autres cas ayant fait l’objet d’articles dans ce blog :
Jean-Baptiste PAUZAT de Zuñiga en 1829 à Bordeaux
Un jugement de la cour de justice de Bordeaux du 18 mai 1829 nous informe qu’un dénommé Pauzat de Zuñiga négociant à Bordeaux était le commissionnaire d’un autre négociant, lui, de Veracruz au Mexique, pour lequel il devait négocier la vente de « 20 surons de cochenille » .
Voir l’article du 27/10/2010
L’abbé PAUZAT en 1899 à Montory
En 1899, une histoire de bancs, à l’intérieur de l’église, fit grand bruit, et les échos parvinrent en haut lieu jusqu’au Président du conseil. ….
Voir l’article du 31/10/2010
Ainsi, nous clôturons la liste, sans doute partielle, de nos ancêtres qui firent connaissance, à juste titre ou à tort, avec la justice de notre pays.
[1] La Justice sous l'Ancien Régime résultait d'un savant mélange entre traditions et édits, entre les coutumes orales et les règles écrites. La France comptait quelque 300 coutumes, dont 60 principales.
[2] La pendaison était la peine commune. La décapitation à l'épée (ou la hache) était un privilège attaché à la noblesse. Le bûcher pour les hérétiques relaps et les incendiaires (le patient était souvent discrètement étranglé auparavant par un lacet). La roue pour les brigands et pour les meurtriers condamnés avec circonstances aggravantes. L'huile bouillante : pour les faux-monnayeurs ; L'écartèlement, avec ensuite exposition des restes aux quatre portes de la cité : pour la haute trahison, pour les parricides. La tête cassée, peine militaire, dont sont aussi menacés les civils qui forçaient les blocus en cas d'épidémie de peste.
[3] Voir l'ouvrage anthropologique d'Emmanuel Le Roy Ladurie : Montaillou, village occitan de 1294 à 1324
[4] La guillotine est une machine destinée à appliquer officiellement la peine de mort par décapitation et qui fut utilisée en France depuis la Révolution française jusqu’en 1977.
[5] Métier ancien existant dans de nombreux pays, il y avait encore 700 porteurs d’eau à Paris en 1879, presque tous Auvergnats !
[6] Aussi identifié avec le patronyme PAUSE
[7] La Terreur est le nom d'une période de la Révolution française (1793-1794), caractérisée par le règne de l'arbitraire et des exécutions de masse perpétrés par les révolutionnaires.
[8] Soit l’équivalent aujourd’hui de 49500 euros
[9] Le corroyeur est celui qui donne aux cuirs, en sortant des mains du tanneur, des façons qui, les rendant plus souples et plus lisses, les disposent aux ouvrages du sellier, du ceinturier, du bourrelier et autres ouvriers.
[10] Saint-Mandé est située à l'entrée sud-est de Paris et au nord-ouest du département du Val-de-Marne, au cœur du plus grand parc boisé de l'Ile-de-France, le bois de Vincennes.
[11] Soit l’équivalent aujourd’hui de 28500 euros